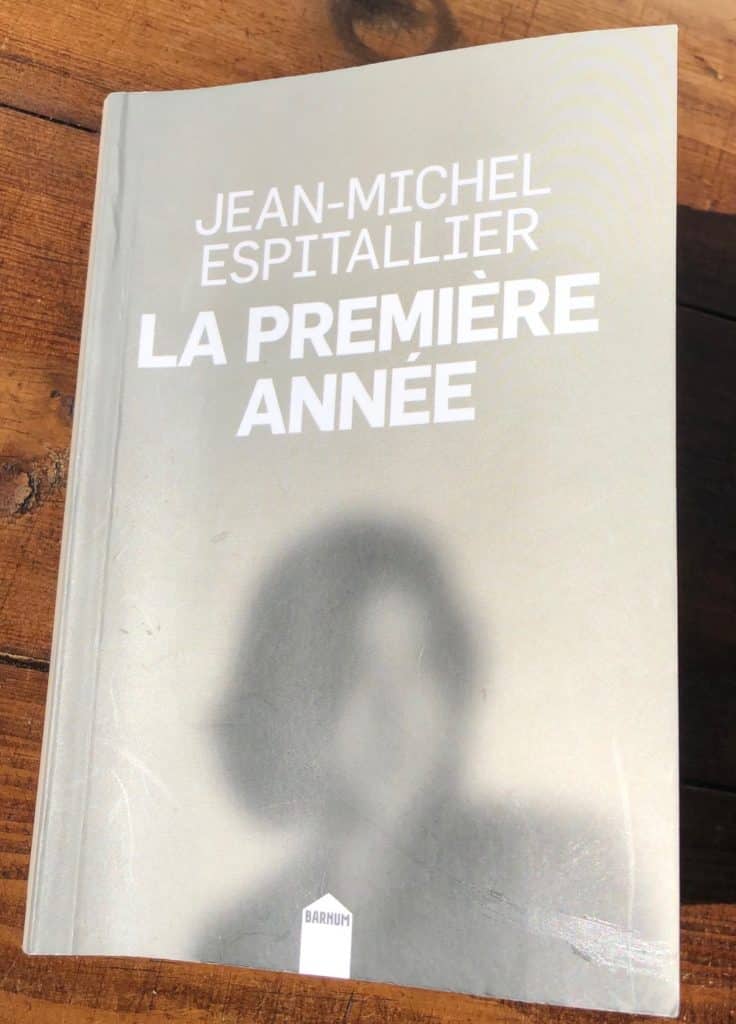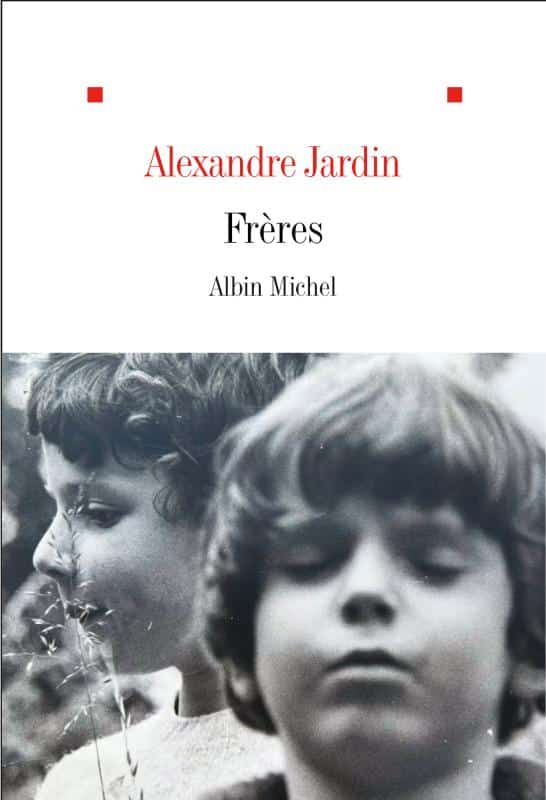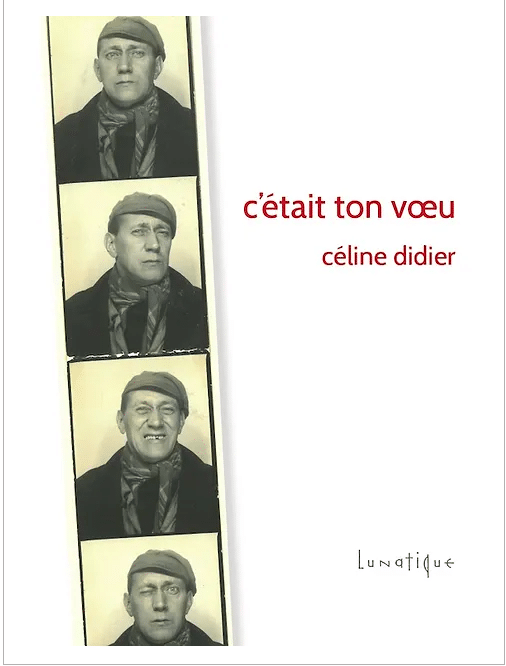Il est des livres dans lesquels on plonge sans réfléchir, et même sans craindre de bousculer les mots, voire de sauter des pages.
Il en est au seuil desquels on hésite parce que le sujet, annoncé d’emblée, fait entrer le lecteur dans l’intime d’une expérience de vie (puisque de mort). C’est le cas de La première année :
« Ce livre est le récit de la mort de Marina, ma compagne, survenue le 3 février 2015, puis le journal de ma première année de deuil. »
Ce n’est pas un roman.
Ce n’est pas de la fiction.
Ce n’est pas non plus un simple témoignage.
Jean-Michel Espitallier ouvre son livre en exposant au lecteur ce qu’est pour lui ce texte :« Un cheminement, une recherche tâtonnante, aveugle. »
« Une tentative d’élucidation, c’est-à-dire au fond, de consolation face à la puissance invasive et irrationnelle de la mort. »
Et plus loin : « Ce livre interroge, parfois avec une certaine insistance, obsessionnellement, l’inaltérable question du temps ».
Ainsi pose-t-il ce qui fait de ce récit, donc de cette lecture une expérience indispensable, singulière, je dirais même essentielle, car il s’agit de tisser un lien entre l’intime et l’ouvert, l’individuel et l’universel, de se confronter aux questions existentielles de la mort et du temps, non pas de manière abstraite mais dans la réalité vécue.
Autant le dire d’emblée, pour toutes ces raisons, ce texte touche profondément, bouleverse et ne quitte pas le lecteur une fois la dernière page tournée.
L’écriture du temps
Indispensable, nécessaire, vitale (et dans ce cas, le terme est à prendre dans toute sa force sémantique) à l’homme de mots, au poète qu’est Jean-Michel Espitallier, l’écriture est le seul recours face à la mort. Elle suit ici au plus près le quotidien des dernières semaines avant la mort et des mois qui suivent. Les traces, les parfums, les objets, les photos… Surgissement des souvenirs, évocation de musiques ou de textes, détails prosaïques mais si nécessaires pour retenir encore la « présence » dans l’absence. Qui a vécu cette expérience de la maladie et de la mort d’un être très proche, trouvera souvent écho, non seulement à ses propres douleurs, mais à sa manière de retrouver lui aussi le chemin de la vie.
L’écriture n’est pas seulement une transcription linéaire de l’année écoulée. Des chronologies se superposent, s’entremêlent, comme si les écrire pouvait maîtriser le temps : celle de la vie avec Marina depuis la première rencontre, celle de la dernière nuit, celle de la première année, celle des affaires du monde…
Le temps qui passe.Les retours en arrière. « Détailler presque chaque minute. » Cela se dit même en secondes. Une seconde, cela peut être si important, quand par exemple il s’agit de celle du dernier souffle.
« 1 h 58.
Tu es partie.
Tu n’es plus là.
Tu es absente.
Tu es morte. »
Une seconde, cela peut être si long quand elles s’ajoutent inexorablement ou si rapide quand c’est un compte à rebours.
Les dernières fois, les premières fois.
Le temps compté, recompté, mesuré, sans cesse.
De manière obsessionnelle.
Et très concrète : cela passe par exemple par le contenu des placards de la cuisine. L’auteur consigne les dates où la nourriture, achetée du temps où Marina était là, est consommée avec elle, puis sans elle, jetée, jusqu’au moment du dernier relief. Au bout de combien de jours, de semaines, les draps du lit, lieu de l’intime, seront-ils changés ? Étapes à la fois symboliques et ancrées dans le quotidien de la vie ensemble rompue.
Est-il possible de « ressouder avant et maintenant en enjambant le présent bègue de ta mort » ?
Habiter l’absence en poète
Bien sûr, le récit est autobiographique, mais c’est celui d’un poète. Il s’éloigne d’une forme conventionnelle pour devenir un chant d’amour et de mort poétique.
La linéarité, la continuité sont brisées, pour poser soudain, détachée, une phrase qui devient comme un îlot, où l’on s’arrête : les mots ont le temps de se charger de toute leur puissance. Des éclats noirs, coupants. Des cris d’angoisse ou de terreur.
Ce sont en effet des fulgurances parfois, par exemple celles du poète qui dit l’insupportable : « Mon insondable tristesse enroulée dans mon incommensurable épouvante », « Un sifflement sourd de douleur noire ». Des oxymores frappants, qui ne laissent aucune échappatoire : « Étrange sensation de liberté. Une liberté totale, absolue. Qui m’emprisonne. » Ou bien cette expression, qui marque l’instant de la mort : « Tout à coup l’hyperprésence de ton absence. »
Quand la certitude de la mort proche est là, tenter d’exprimer ce qui n’est pas concevable. Comme en exergue du récit, cette litanie de questions qui disent l’affolement :
« ainsi donc, tu vas mourir ? tu vas donc mourir toi aussi ? me laisser ? partir sans moi ? sans nous ? vraiment partir ? me laisser te laisser ? toi aussi, partir ? seule ? tu vas donc mourir toi aussi ? mourir sans nous ? me laisser te laisser ? partir ? mourir ? mourir, toi aussi ? seule ? alors, comme ça, toi aussi tu vas donc mourir ? tu vas donc mourir toi aussi ?»
Ce travail sur la langue est constitutif de l’objet même du livre, puisque c’est cette rédaction qui porte l’auteur pendant tous ces mois : « Liquider mon traumatisme en le racontant pour lui donner forme. Pour lui donner langue. » Il parle, avec des accents rimbaldiens, du besoin de chercher comment dire :
« Tristesse infinie. Cette expression ne colle pas. Elle met en mots, en mots déjà utilisés, usés, en mots d’occasion, ce qui dépasse le langage, ce qui est unique et sans équivalent. Ce qui n’a pas de mot. En deçà et au-delà du langage. En mots plus grands que la bouche. Non, je ne suis pas dans une tristesse infinie. Je suis la tristesse du monde. L’infinie tristesse du monde ».
On entend aussi d’autres voix comme des échos : l’auteur rapporte les phrases soulignées par Marina dans le Journal d’Isabelle Eberhardt, son «livre ami », qui tracent « l’esquisse d’un autoportrait», ou le vers magnifique de Rimbaud :
«C’est la mer allée
avec le soleil»
L’écriture, cheminement, consolation, espace de vie possible : « Le monument, c’est le livre. D’ailleurs, je ne suis à peu près bien qu’ici, dans cet espace d’écriture où je te retrouve. Où je me retrouve te retrouvant. T’écrivant (mais pourrai-je finir de l’écrire ?). »
« Un an après, je pars dans l’inconnu
Et c’est l’éternité. »
« … alors, tout recommencerait »
La Première année est un livre de larmes, de temps qui passe, d’où ressurgit la pleine vie

Editions Inculte, 2018 et en poche 2021