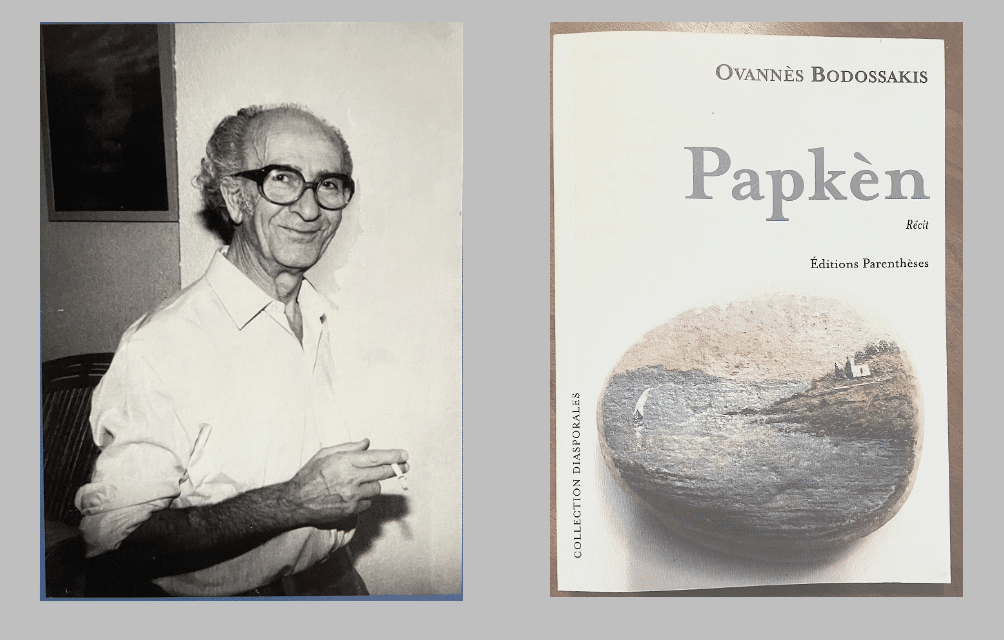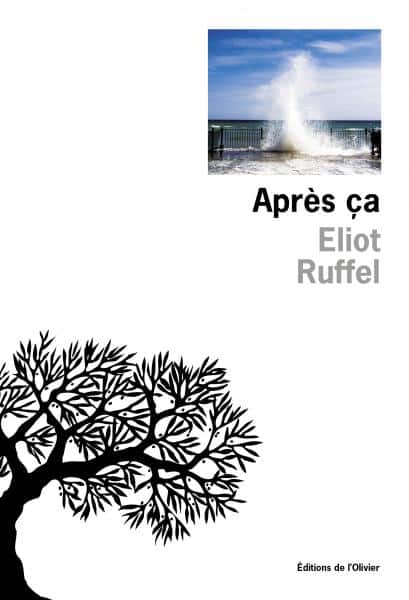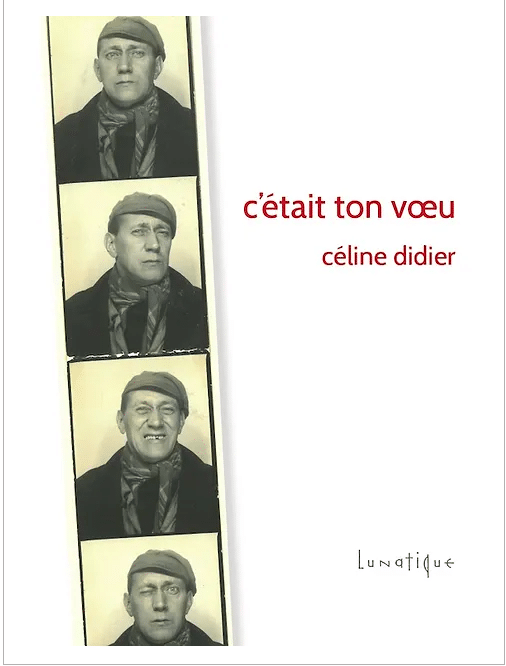Note de lecture d’Evelyne Sagnes
« Beaucoup de livres ont accompagné cette rêverie autour de Lucia Joyce. » Note de l’auteur.
Cette remarque d’Eugène Durif définit la singularité de ce texte : nourri de lectures, très documenté, il relève en même temps de l’écriture romanesque, voire poétique, d’une forme de fiction. Il convient de rappeler que l’œuvre de James Joyce, James Joyce lui-même et sa famille, son entourage, font partie de la vie de l’auteur depuis de très nombreuses années. Une fréquentation quotidienne, une proximité, une fascination même, pourrait-on dire. Plus particulièrement ici il s’agit de la folie de Lucia Joyce, un sujet qui le touche de près : « Dans ma vie, je n’ai cessé de croiser des gens atteints par la maladie de l’âme. On peut appeler cela comme ça, pour ne pas avoir à utiliser la nosographie et ce qu’elle a d’impersonnel. Moi, je n’y arrive pas : schizophrénie, hébéphrénie, paranoïa… Je n’ai jamais supporté de localiser l’autre et son étrangeté de façon aussi limitée. »
Ce livre est l’une des formes abouties que prend ce cheminement au fil des années.
Double « je »
Pour commencer, première surprise : c’est Lucia Joyce qui est la narratrice. « Je me suis glissé dans la peau de cette femme. » dit l’auteur. Un long monologue, entrecoupé de quelques passages sous formes d’extraits de lettres de son entourage, ou de récit à la troisième personne. Eugène Durif parvient à se faire oublier complètement : c’est la voix de Lucia qu’on entend. L’auteur « connaît » si bien son personnage qu’il peut imaginer ce qu’elle ressent, ce qu’elle vit, ses sensations. C’est vertigineux : qui parle donc ? Lucia, oui, mais Eugène aussi. L’une et l’autre. L’un est l’autre.
« Moi » éclaté et brisé
« Dans le miroir » : c’est le titre du premier chapitre. Le miroir où l’on se voit, dans une sorte de dédoublement inversé, permettrait-il de savoir qui on est, grâce à cette distance ? Pourtant, dès les premières lignes, c’est une interrogation : « C’est moi là, telle que je suis, telle que j’apparais dans ce miroir. Est-ce que je suis devenue vraiment celle que je parais là ? Ce n’est pas possible qu’il n’y ait pas encore à l’intérieur de moi une autre femme ou une autre fille, celle que je n’aperçois plus que très rarement. » Étrangeté à soi et aux autres. Alors qu’elle cherche à reconstituer son histoire, elle dit : « C’est là que je me suis absentée, l’impression de m’être quittée tout à fait, morte à moi-même. »
Une jeune femme brillante, aux nombreux talents artistiques, peu à peu poussée hors du monde, déçue aussi par une histoire d’amour avortée, ou peut-être complètement fantasmée par Lucia, avec Samuel Beckett, qui travaillait avec son père.
Père et fille, une relation vitale et mortifère
Folle fille de son père : le titre en dit long. Il y a le poème de James Joyce, en exergue du livre. Il est intitulé « Une fleur offerte à ma fille ». Elle-même veut écrire un livre sur son père : La vraie vie de James Joyce par sa fille Lucia. Une fois qu’elle l’aura écrit : « Tout commencera vraiment ; tout ce qui a été manqué, raté, oublié, cette fois on repart de zéro. Dans cette histoire où il faudrait que je commence à savoir où je suis. Et, cette fois-ci, commencer à la vivre. »
Lucia s’adresse à son père, qu’elle adule et qui seul, pense-t-elle, pourrait la sauver. La sauver d’elle-même d’abord. Des autres. De sa mère à qui elle fait peur dans ses accès de violence. laquelle affirme dans une lettre à Jim (James Joyce) : « Ne te mens pas à toi-même, tu ne peux la sauver, il faut l’envoyer avant tout dans une maison de santé, rien de suivi n’a été fait, Georgie [le frère de Lucia] est furieux, il pense que nous jetons l’argent par les fenêtres. »
Elle est en constante relation avec ce père, une relation passionnée, passionnelle, voire pathologique. Dialogues rapportés du passé, dialogues imaginés depuis sa chambre d’hôpital. Elle l’appelle « Babbo », s’adresse à lui, le supplie de l’aider. En même temps, cet amour l’étouffe. L’empêche de vivre.
Une écriture puissante et hallucinatoire
Si le récit d’Eugène Durif fait entrer le lecteur dans l’histoire de James Joyce, écrivain et père, et de sa fille, artiste aux multiples talents, de leur famille, de leur entourage, grâce à un travail de recherches et de lectures approfondi, il est aussi, je dirais peut-être même surtout, étonnant par l’écriture elle-même. Précise lorsqu’Eugène Durif, rapporte des faits, établis, elle devient lyrique, en ce sens qu’elle exprime la violence subie dans un flot verbal dont le rythme ne faiblit jamais. Elle est vivante, car elle épouse le mouvement incessant des pensées, des sentiments de Lucia : le monologue intérieur, en fait adressé par Lucia à son père, est parfois factuel, posé, et brusquement il est traversé par un cri de désespoir, de douleur, d’appel à l’aide, qui se développe, enfle et se déploie. Lucia est débordée par ses émotions, les mots se bousculent, se heurtent, se répètent, dans une écriture mimant l’affolement, la terreur.
Voici, pour exemple, le début du chapitre intitulé LE TRIBUNAL DES MÉDICASTRES
« C’est la nuit qu’ils arrivent. C’est la nuit qu’ils reviennent. Cela pourrait faire penser à un rêve ou à un cauchemar. Mais c’est encore autre chose. Ils sont là toutes les nuits ! Avec tous les mots, les mêmes jugements, souvent que je ne comprends pas bien, je n’en perçois pas toujours le sens, ou alors lointain, mais je ne peux les oublier, chaque sentence, là, gravée et condamnée encore à me revenir, à même la peau. C’est la nuit qu’ils sont là, armés des phrases qu’ils me jettent dessus, en pleine nuit, c‘est en pleine nuit, ils sont tous là réunis, rassemblés à pérorer à mon sujet.
Et moi, rien ne peut me venir aux lèvres. Si encore je pouvais crier. Mais rien ! Lèvres closes ! comme scellées, toutes blanches, tellement je les ai mordues ! Ou alors, un cri du dedans tellement fort que tout le corps arrêté, immobile ! Babbo, ne me laisse pas seule avec eux ! Je me bouche les oreilles mais leurs mots s’incrustent un peu partout !
[…] Ils surgissent encore dans un bruissement insensé, une sorte de musique de sons déformés, discordants, de phrases effrayantes, étirées sur la fin en ricanements glaçants ! »
Un spectacle a été créé par Éric Lacascade, avec Karelle Prugnaud (Lucia) : un monologue intitulé Le cas Lucia J. [Un feu dans sa tête].
L’expression « Un feu dans sa tête » dit la souffrance permanente, le déchirement intérieur sans fin, l’écriture d’Eugène Durif les rend présents et bouleversants.
Editions du Canoë, 2022