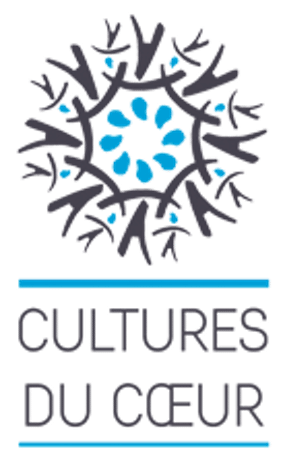© Bruno Dubreuil
Hélène Gaudy nous offre un texte inédit. il parle de photographies. De leur capacité « à contourner les lois du temps ».
L’écriture et la photographie, si liées pour l’autrice.
Qui sait ? Peut-être ce texte porte-t-il en germe son prochain roman ?
Hélène Gaudy a publié de nombreux livres (littérature générale, littérature pour la jeunesse, livres d’art).
Parmi les parutions récentes (ou récemment en poche)
Vues sur la mer, Babel Actes Sud, 2020
Si rien ne bouge, Babel Actes Sud, 2014 (Le Rouergue, 2009 )
Une île, une forteresse, Babel Actes Sud , 2017 (Inculte, 2016)
Plein hiver, Babel Actes Sud, 2020 (Actes Sud, 2014)
Le dernier paru : Un monde sans rivage (Actes Sud, 2019). Sélection Goncourt 2019.
Une note de lecture de ce roman par Evelyne sur son blog Médiapart
Un entretien à La grande table par Olivia Gesbert, France Culture
Le Matricule des anges, octobre 2019 n°207, lui a consacré son dossier.
En fin de cet article une présentation en vidéo par l’autrice.
« Le premier désir est venu d’une série d’images retrouvées sur l’île la plus proche du pôle Nord : trois explorateurs littéralement tombés du ciel dérivent avec la banquise. À travers l’épaisseur du temps, ils nous dévisagent. Si toute photographie est l’empreinte d’un corps traversé par la lumière, celles-ci, qui ont si longtemps séjourné dans la glace, sont aussi la trace directe, physique, d’un paysage. Elles me happent par leur présence spectrale, leurs zones d’ombre qui sont déjà le début d’un roman. » Hélène Gaudy.
Hélène est également membre des comités de rédaction d’Inculte et de La moitié du fourbi.
De 1991 à 2017, dans la série Leaving and Waving, l’artiste Deanna Dikeman a photographié ses parents à chacune de ses visites à leur domicile dans la ville de Sioux City, dans l’Iowa. À chaque fois, une image du même instant : elle s’éloigne au volant de sa voiture et ils agitent la main pour lui dire au revoir.
Mes parents et moi avions le même rituel avec mes grands-parents maternels : nous ne prenions pas de photo mais il ne se passait pas une visite dont nous ne respections le point final — les regarder agiter la main jusqu’à ce que leurs silhouettes, devant l’entrée de leur maison, disparaissent.
Ces moments, toujours accompagnés d’un pincement au cœur à l’idée qu’ils puissent être les derniers, sont l’un des souvenirs les plus nets de mes étés d’enfance. Je ne pouvais jamais tout à fait me défaire du sentiment désagréable de me prêter à une sorte de répétition générale des adieux que nous aurions à nous faire un jour et qui, malgré tous nos efforts, ne pourraient ressembler à cette scène mille fois répétée. Le jour où ils partiraient, personne n’agiterait la main. La mort nous prendrait par surprise, quelle que soit notre volonté de nous y préparer. Malgré tout, je me pliais au rituel, comme à tous ceux qui agacent et fondent les familles — les repas, les Noëls, les au revoir, ces instants dont la répétition accentue l’épaisseur, solidifie la mémoire. Et leurs visages, devant la maison, me bouleversaient.
En regardant les photos de Deanna Dikeman, je retrouve l’attendrissement et l’obligation, l’ennui et la tendresse, l’anxiété et la superstition. Parfois, le champ est large : on voit la maison basse, la façade peinte en rouge, la neige qui couvre le jardin, une décoration de Noël sur un arbre. Parfois, ils se pressent tout près de la voiture comme s’ils suppliaient leur fille de les emmener.
La mère semble souvent plus triste que le père. Elle force son sourire alors qu’il laisse éclater le sien, inconscient de son image. À la fin, dans son visage décharné, on ne voit plus que ce sourire plein, entier.
La vie passe, en accéléré, mais elle ne laisse pas toujours les traces qu’on attendait. Les parents ne semblent pas vieillir au rythme des années. Ils paraissent plus vieux en 1995 qu’en 1998, le père, surtout, qui au début de la série est déjà un homme maigre aux veines proéminentes, au visage réduit à ce qui saille ou se creuse, alors que sur certaines photographies prises plus tard, il semble retrouver de la chair au gré des événements de sa vie invisible : d’un coup, ce n’est plus le vieillard qu’on s’attendait à voir s’éteindre, c’est un gamin malicieux qui fait une bonne blague. Le vieillissement, nous disent ces images, est fait de pics et de retours en arrière, de résurgences de la jeunesse ou de l’enfance.
Et puis un jour, il n’est plus là. La mère est accompagnée d’une autre femme, sa sœur sans doute, elles se ressemblent, elles se tiennent par la taille, comme avant, comme avec lui, et c’est la sœur qui a l’air le plus triste, comme si la mère avait repris le rôle que son mari tenait si bien sur les images. Bientôt, elle va se mettre à lui ressembler de plus en plus, devenir le père et la mère à la fois, absorber son souvenir. Avant la fin de l’année, les abords de la maison sont vides. La porte du garage est fermée.
La vie est passée. Les photographies ont fait leur travail de photographies, elles ont marqué les étapes qui mènent vers la fin, en ont accumulé les traces. Mais ce n’est pas cela, finalement, qu’on retient : plutôt leur capacité à se faire les témoins des métamorphoses, à accueillir la surprise, à révéler la verdeur d’un passé qu’on croyait derrière soi comme l’obsolescence brutale de certains avenirs — à contourner les lois du temps.
Hélène Gaudy présente son livre Un monde sans rivage (Actes Sud, 2019)
Hélène Gaudy présente son roman