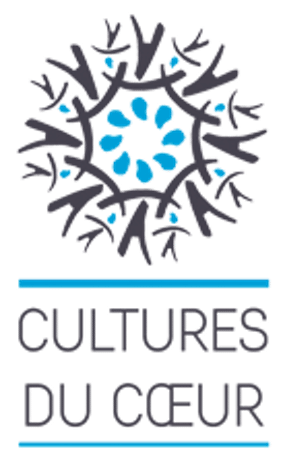Laurence Vilaine sera en résidence en juin et septembre à Reillanne (04), invitée par Désirdelire.
Elle est présente dès maintenant avec ce texte offert à l’association et donc à vous.
Des informations sur l’autrice ici et sur la résidence ici.
Frigo et mimosa
Il s’est installé là, un matin frais, et n’en a plus bougé.
Le jour comme la nuit, sous la branche la plus basse.
« Rodâdad • avril-septembre »
Ce qui ne dit rien de son âge, seulement une trace de son passage.
Depuis le 1er octobre, le tilleul est orphelin.
Ça part d’un coup de vent, d’une poussière dans l’œil, d’une lumière d’été – quel été ? On peut fouiller les étés aussi loin qu’on peut, marcher dans le sable ou retourner la terre, d’un coup de pelle sans faire exprès couper un lombric en deux et se rassurer à voix haute, le lombric repousse, le lombric repousse quand on le coupe, et croire dur comme fer à ces dires des grands-mères, le lombric repousse quand on le coupe, un peu comme les tiges des tulipes dans les vases et on ressort même le vase du buffet, attention de ne pas heurter celui qui est devant, il est fragile, on ne s’en sert jamais de peur de le briser, pourquoi on ne le range pas derrière alors et à quoi ça sert d’enfermer le vase de l’aïeule, de ne jamais s’en servir et puis ça ferait quoi de le perdre finalement ? Les tulipes se moquent du contenant, elles continuent de grandir du moment qu’elles ont les pieds dans l’eau. Ce n’est pas comme le lombric coupé en deux, on sait bien, on sait bien qu’il ne survivra pas, il n’y a que dans les mythes qu’il pourrait avoir deux têtes, mais les Grecs ne se sont guère préoccupés des vers de terre. On peut retourner loin dans les étés, faucher à la serpe, installer l’escabeau sous le cerisier, on peut comme ça réveiller des dizaines de juillet, des rougeurs sur les cuisses à cause des chutes dans les orties, des petits shorts en coton, des cordes d’espadrilles qui s’effilochent et des piqûres de moustique avec l’odeur du vinaigre, sous les draps blancs, on peut réveiller le cri de la chouette et fermer la fenêtre, ça fait moins peur, mais toujours ça démange, surtout aux pieds les piqûres qui font des boutons durs près de l’os saillant du côté. On peut fouiller des étés, et puis, allez savoir comment, pourquoi, un jour ça surgit d’ailleurs, de sous la glace, d’un hiver enfoui, d’un regard croisé dans la file d’attente à la boulangerie, d’un couloir de métro ou d’une guerre qui explose, à la radio, dans un pays que je ne sais pas bien où poser sur la carte, je vérifie, déjà j’en connais le nom, je m’y accroche, parce qu’à s’accrocher à du connu, on a la tête moins perdue ?
– c’est du début des romans dont je parle.
« Rodâdad • avril-septembre »
C’est moi qui ai gravé et fixé la plaque sur le tronc, comme un nom de rue pour ne pas oublier,
mais surtout exprès pour tenir tête à ceux qui voulaient qu’il disparaisse.
Écrire avec du connu, oui, on a la tête moins perdue. Ce que notre mémoire conserve, c’est là, dans des citernes pleines à ras bord, y a de la matière, de quoi ouvrir un petit magasin de souvenirs et hop, on sort les brosses et les chiffons de laine pour les faire reluire. Et puis ? Non, les chiffons de laine pour le roman, c’est pas bien folichon. C’est dans le fond de la citerne qu’il faut aller gratter. Bien au fond, ou dessous, ou ailleurs.
Folichon – il aurait pu dire ce mot-là, Rodâdad.
La première fois qu’il a parlé, on est tous restés bouche bée.
Les idiots ont ri, les peureux sont partis, les pires ont haussé les épaules.
Parfois (le début des romans, toujours), ça part d’une voix. Qui caresse, ou qui râpe ou qui chante. Est-ce que dans le roman on entend les voix des personnages, est-ce qu’on les invente ou est-ce qu’elles sont l’écho des voix qu’on entend depuis qu’on est né – combien, depuis qu’on est né ? Les voix des villes, des trains, de la nuit, les qui violentent, les qui remercient, qu’on veut ne pas oublier. Celles du cinéma, des églises, de l’opéra, des politiques, les voix de l’amour, des petits matins, du mendiant, du sauveur ou du bourreau, du corbeau, et pas deux identiques – est-ce qu’on connaît la voix du personnage qui raconte ?
Si je parlais russe ou hébreu ou arabe ou portugais, je ne penserais pas pareil…
– qui parle ?
L’écouter. Le laisser dire « je », sans savoir qui il est, surtout ne pas l’interrompre. Qu’il se sente libre, lui faire savoir que la voie est libre.
Je ne connais rien du personnage qui veut narrer l’histoire – quelle histoire ? Le laisser parler, écrire ce qu’il a à dire, au fur et à mesure ou par à coups, ne pas lever les yeux au ciel s’il se répète, être là s’il cherche ses mots, sortir le Livre de la Genèse ou des Jubilés, fouiller les sourates avec lui, rebâtir la Tour de Babel, prendre le temps nécessaire.
Il a attaché la plaque au tronc du tilleul, une planche en bois, un trou de chaque côté, un fil de fer tortillé comme des vrilles de vigne.
Je le vois venir. Je le vois venir, avec sa plaque.
Je la vois venir, l’histoire qui commence par la fin, chaque fois c’est pareil, marcher à contre courant, remonter le torrent. C’est qui ce Rodâdad ? Un égaré du Cantique des oiseaux ? La huppe travestie ? En tout cas, j’ai griffonné son nom plein de fois et ça sent le tilleul dans mon carnet. Rodâdad, qui arrive avant tout le monde, même avant l’histoire. Rodâdad, l’éclaireur. Et le narrateur n’est pour l’instant pas très bavard. Lui et moi, on ne sait pas bien où nous asseoir, on reste debout et ça ressemble à un conciliabule – oui, ce serait comme un conciliabule, le début des romans, mais sans rien du complot. Plutôt une poignée de main qui scellerait un pacte de confiance.
S’en remettre à celui qui veut narrer, sans le connaître et sans savoir ce qu’il a à dire.
Écrire avec ce qu’on ne connaît pas.
À bien regarder, on voit un trou dans le tronc du tilleul.
C’est le silence de Rodâdad qui l’a percé.
Indicible.
Qu’on ne peut pas exprimer avec des mots. Parce que ça relève de l’intense, de l’étrange.
Le beau, le rien, le silence – ce qu’on pense ne pas pouvoir traduire en mot, parce que ça ne se décrit pas, ça se respire, ça se touche, ça se vit, le parfum du mimosa, le désir, l’effroyable. Sauf qu’à force de travail et de stratégies, on y arrivera bien, on peut toujours essayer de bourrer son oreiller de boules de mimosa séchées pour le sentir autrement, marcher pieds nus dans la neige ou mettre la tête dans le frigo pour écrire le froid, ça prendra le temps que ça prendra, ça donnera ce que ça donnera.
L’indicible, parce qu’inavouable. L’indécent. Au point de ne pas vouloir dire. Ou ne pas pouvoir. Question d’honneur, d’amour propre. De vie ou de mort.
Qu’on ne peut pas dire, pas écrire – parce qu’on ne sait pas.
L’inconnu.
Indicible parce qu’inconnu.
C’est celui-là. C’est cet indicible-là qui justement fait écrire, que le roman fait surgir. Sans lui, le roman sera plat. Le roman ne sera pas. Au début, le roman marche sur des sables mouvants. Pas d’ossature. Pas de squelette.
Ça part de là, oui, c’est pour trouver l’inconnu que le roman s’écrit et grâce à lui qu’il tiendra debout.
Un tilleul, une pancarte en bois.
Partir avec ça.
Aux aguets, mais sans traque, parce que l’inconnu résiste. Il se terre s’il se sent menacé, inutile donc de vouloir à tout prix le débusquer. Ne pas non plus tenter ou être tenté de l’inventer pour aller plus vite : l’inconnu ne s’invente pas, il existe.
Remonter le torrent. Arpenter les berges, enlever ses chaussures, les remettre, nouer et dénouer sans cesse ses lacets. Quand alors, un matin, un caillou branle sous les pieds, quand sur un chemin la terre craquelle et un peu se soulève, le roman serre les poings. C’est quelque chose comme ça, oui, l’indicible, c’est l’inconnu qui s’écrit avec le cœur qui bat vite et tous les doigts ensemble. Le roman sait alors pourquoi il a fait tout ce chemin.
Un tilleul, une pancarte en bois. Remonter jusqu’à la source. On peut alors faire des bouquets de mimosa pour le plaisir d’offrir et sortir la tête du frigo.
Laurence Vilaine, mars 2021.