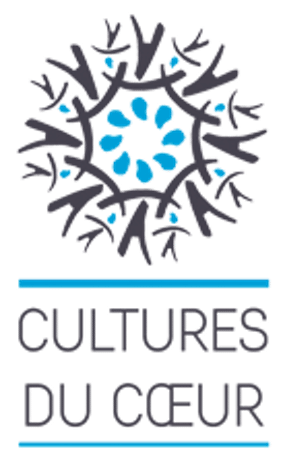Voici un texte inédit signé Arno Bertina, confiné n*5326844.
Relire Hemingway, le comparer à Dostoievski… Pour qui va sonner le glas ?
Pour en savoir plus sur l’auteur (que nous avons aussi invité le 29 mai 2021) c’est ici.
Pour qui sonne le glas, Ernest Hemingway (1940)
Dès le premier jour du confinement je me suis penché sur mes Faulkner et va savoir pourquoi c’est un Hemingway qui est sorti : Pour qui sonne le glas. C’est un peu idiot, je n’en avais pas tellement envie… J’avais oublié qu’il portait sur la guerre d’Espagne… Malgré ça, je peine un peu, et pourrais m’en tenir là (je viens de passer le premier tiers). C’est d’autant plus tentant qu’au bout de cent pages je me suis fait cette réflexion (sans doute idiote) qui, je l’avoue, m’a démobilisé : « Ce n’est pas Dostoïevski. »
Pourquoi ? Que vient-il faire là, celui-là ?
Dans le long passage du chapitre X dans lequel Pilar décrit le massacre de vingt fascistes par des républicains ivres morts, la compagne de Pablo dit que ce dernier aurait pu abattre lui-même ces bourgeois solidaires de l’armée. S’il ne l’a pas fait, convoquant au contraire tous ces paysans acquis à la cause de la République, c’est « pour que chaque homme ait sa part de responsabilité » ; qu’ils soient tous soudés par ce crime, en quelque sorte.
Cette « astuce » m’aura sans doute fait penser au stratagème inventé par Verkhovenski, dans Les Possédés, ou : Les Démons, pour souder le petit groupe de révolutionnaires qu’il a rallié à son projet insurrectionnel. (Amener le groupe à tuer l’un des leurs de manière à ce qu’ils se tiennent tous, et qu’aucun ne puisse plus faire machine arrière ou dénoncer les autres.)
Mais cette réminiscence est restée enfouie car je ne fais ce parallèle que maintenant, en rédigeant ce petit texte.
Lisant ce passage (le massacre des fascistes), je venais d’entr’apercevoir ce que Dostoïevski aurait fait des tiraillements et des convictions des républicains espagnols.
Le roman d’Hemingway suit un Américain, Robert Jordan, qui se bat contre le fascisme. Tout lecteur d’Hemingway sait qu’il a lui-même fait le coup de feu, en Espagne, qu’il était donc du même côté que son personnage. Qu’il y a-t-il dans ces quinze pages ? Les bons (les paysans républicains) s’avèrent des brutes difficiles à cautionner, tandis que les salauds qu’on exécute ne sont pas tous les salauds qu’on voudrait – l’un est un commerçant apprécié, sans fortune car il n’arnaque pas ses fournisseurs ; un autre n’a pas encore vécu grand-chose et tremble comme une feuille à l’idée de mourir, etc.
Écrivant presque contre son camp, Hemingway dut se dire qu’il ne faisait pas un travail partisan mais une œuvre littéraire. Il se montrait libre. Á la façon, en quelque sorte, de Bernanos écrivant Les grands cimetières sous la lune pour dire son dégout devant les crimes des franquistes.
Est-ce que cela suffit ? Est-ce vraiment cela, penser contre soi-même ?
Comme tout un chacun, je sais le réactionnaire intraitable que fut Dostoïevski à partir d’un certain moment, mais comme tous ses lecteurs je sais aussi que ses convictions ne l’ont pas empêché de continuer à tourner autour de ses personnages, de les rendre tous fascinants à un moment ou à un autre : dans Les Démons, il s’en prend aux révolutionnaires socialistes, mais le génie maléfique du petit groupe d’insurgés qu’il met en scène, Piotr Verkhovenski, passe son temps à souffler sur les braises et prend sur lui toute la folie de l’entreprise.
Or, dans une scène d’une intensité sidérante, il tente de retenir Stavroguine en lui disant par trois fois[i] qu’il n’est pas un « socialiste » mais un « escroc ». « Socialiste », qu’est-ce que c’est ? Une identité, des raisons, un manteau ou un habit. A ce titre « escroc » ne peut pas
A ce titre « escroc » ne peut pas remplacer « socialiste » terme à terme ; « escroc » n’est pas une identité mais l’annulation de l’identité précédente. Ce n’est pas non plus une conviction, c’est le brouillage de celle-ci. La voie est alors dégagée pour qu’apparaisse, sous le masque arraché, quelque chose d’autre.
Dostoïevski fait alors un croc en jambe à ses propres fureurs (qui visent le progressisme). Mais ce n’est pas exactement ce qui m’intéresse ici. Qui demandait au Russe ce tour de vis supplémentaire, revenant à sortir de son viseur la question du socialisme et du progressisme ? Personne. C’est que l’écrivain veut aller dans ses œuvres aux confins de la politique, il veut dénuder toutes les forces, voir ce qui se cache derrière (nos idées politiques ne sont que des vêtements) : Piotr Verkhovenski est porté par une sorte de passion de la destruction. Plus on avance dans le roman, moins c’est un personnage ; c’est une puissance noire, un démon tournant autour de la création. Tenir les autres, et tout faire sauter avant que quiconque ne descende du bateau. En tant que force, il fascine l’écrivain, qui, dès lors, ne dialogue plus avec son personnage comme il pouvait le faire dans les premières pages du roman (où l’on n’entend que son ironie, incroyablement acerbe).
Hemingway ne vit pas dans le même monde. A la différence du Russe, le sien est sans Dieu. Peut-être est-il même au-delà du drame que représenterait pour Dostoïevski un monde sans Dieu. Ses personnages étaient seuls, jusqu’à ce roman espagnol (qui décrit des collectifs). Mais la question n’est pas celle-ci : dans cette scène (le massacre d’un prêtre et vingt fascistes), Hemingway inverse les rôles attendus – s’il ne l’avait pas fait, on aurait une œuvre de propagande – et il s’en tient là. Il retire la casserole du feu bien avant que l’eau ne soit à ébullition. Partant, le sens du passage serait celui-là : la guerre révèle de sales choses, on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs, les héros puent parfois le vomi, etc. Parce que c’est peu de choses, je pense que le vrai résultat est à trouver ailleurs, et d’abord dans cette idée qu’il aurait réussi à éviter un piège (le chromo ou le bas-relief soviétique montrant, à la façon du lyrisme stalinien, des héros magnifiques, face au vent, etc.)
Hemingway apparaît plus qu’il ne l’imaginait. Il pensait ruser, être insaisissable, mais il est si content de ça qu’il se fait choper. On le voit tellement à la manœuvre, dans cette scène, en amont (les intentions) et en aval (le pseudo-résultat), qu’elle en devient sans intérêt. Au contraire, Dostoïevski se prend de vitesse lui-même, en donnant aux personnages ce tour de vis supplémentaire ; il ouvre le champ à la poursuite d’une nouvelle fulgurance après laquelle il se remet à courir comme un dératé.
Il ne suffit pas de penser contre soi-même : il faut encore être fasciné.
Arno Bertina, confiné n°5326844
[i] Entre les pages 366 et 368 du volume 2 de l’édition Babel-Actes Sud, traduction A. Markowicz. Soit le chapitre 8, intitulé « Le Prince Ivan ».
A propos de son dernier livre, L’âge de la première passe (Verticales, 2020) une chronique ici.