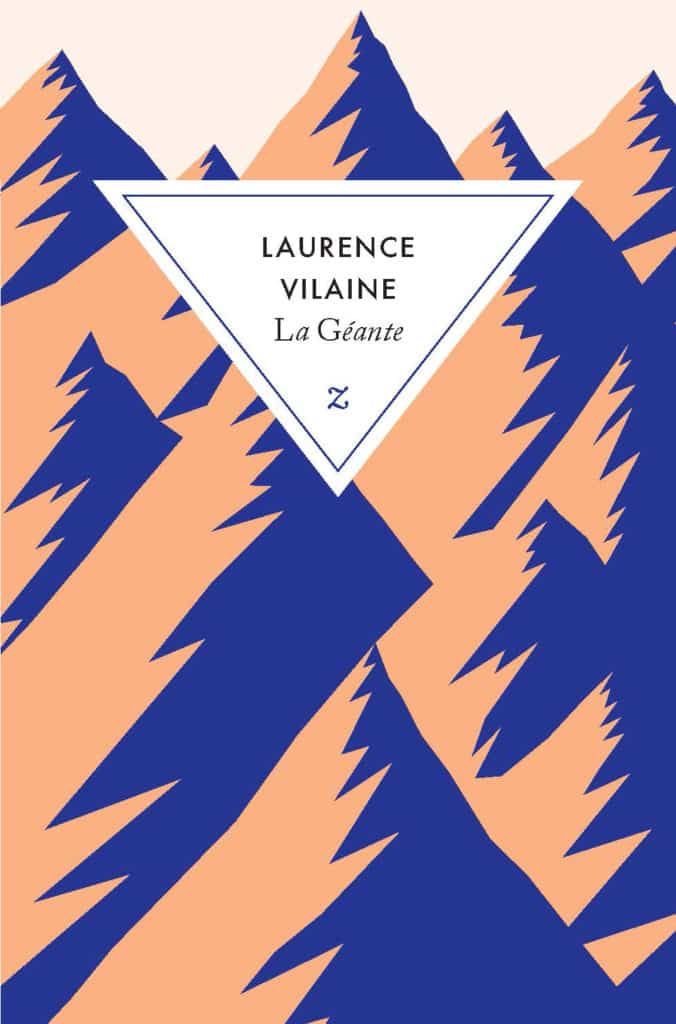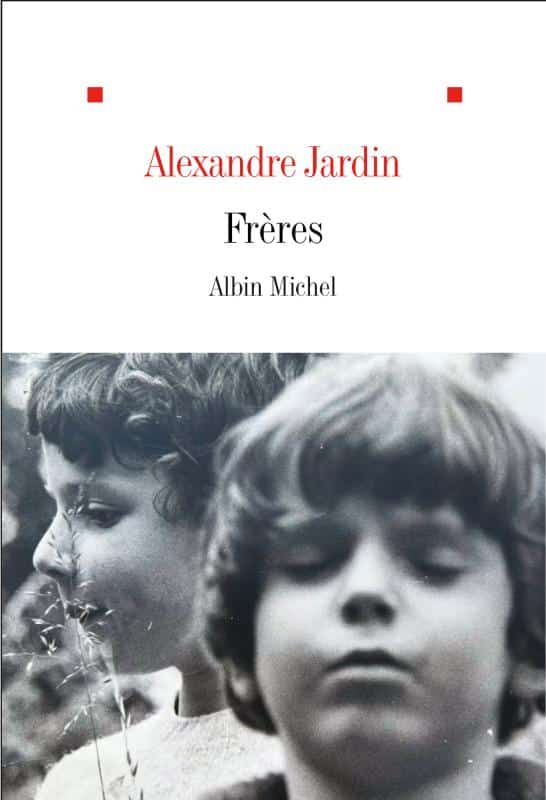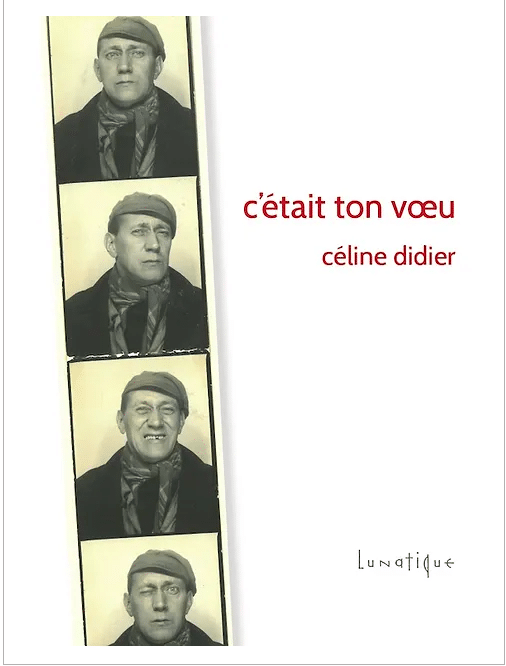Désirdelire accueille Laurence Vilaine en résidence en 2021.
La Géante, une histoire de mots, qui vont parfois au-delà de leur destinataire, de silences subis ou souhaités, d’amour et de désir.
Un roman où regarder le ciel est une libération et une révélation à soi-même.
Une écriture singulière qui fait surgir les images et dit avant tout le sensible.
Evelyne en avait fait une recension sur son blog www.tribunelivres.com : nous la reprenons ici.
Quatre personnages… et une montagne
Quatre personnages, un hameau au pied de la montagne La géante. A des titres différents, c’est elle qui les révèle tous à eux-mêmes. À chacun sa vérité… ou son mensonge.
La narratrice, c’est Noële, elle vit là depuis son enfance. Elle cueille et prépare les plantes qui « réparent », et elle fait à merveille les fagots nécessaires pour allumer le feu.
Maxim, un journaliste, est venu se réfugier dans ce lieu perdu pour mener en solitaire un combat contre la maladie.
Carmen, la femme qui aime Maxim, prise par ses occupations à travers le monde, lui écrit, inquiète : ce sont ces lettres qui vont tomber entre les mains de Noële et changer sa vie, ou plutôt sa vision de la vie. Un jour Carmen est là : le roman commence avec son arrivée dans le hameau.
Rimbaud, le frère de Noële, surnommé ainsi par sa sœur. Il a le « sourire des bienheureux », et passe son temps à chercher dans les ruisseaux « des cailloux qui brillent, les ors des fous ».
Et la montagne, La Géante, vivante, mystérieuse et familière, bienveillante et dangereuse, gardienne des secrets des hommes.
Mots, cris et silences
Je pourrais dire de manière un peu abrupte que l’intrigue est simplement une histoire de mots : ceux qui sont dits, ceux qui sont écrits, ceux qui restent au fond de la gorge, ceux qui disent le vrai et ceux qui mentent, ceux qui font douter, ceux qui n’arrivent jamais à destination, ceux qu’on emprunte, et qu’on ne rend pas, ceux qui ouvrent des champs inconnus, ceux qui ferment définitivement les portes, ceux qu’on murmure, ceux qu’on hurle, ceux « qu’on ne pensait jamais dire »… car c’est peut-être cela aussi la « légende », l’un des premiers mots du texte, étymologiquement parlant : « ce qui doit être dit », « la force des mots » au-delà de la volonté de chacun.
Il y a aussi « les mots justes », justes «parce qu’eux-mêmes ont retenu l’essentiel… et qu’ils ont la force d’une armada de poings contre la mort, la vie à gagner sinon rien » : c’est Noële qui parle des lettres de Carmen qu’elle lit par effraction, quand Maxim lui demande de ne plus les lui apporter, mais cela pourrait bien être la définition de l’écriture de Laurence Vilaine.
Une histoire de mots, mais aussi une histoire de silences.
Le silence, les silences… Car ils sont de nature bien différente : Carmen évoque dans une lettre « L’heure des silences qu’on chuchote » moments heureux partagés, ceux qui sont douleur : « Tu entends ce silence-là, comme il mord ? » Le silence comme « arme de combat » pour Maxim, qui voulait « tout éteindre, le volume en même temps que la lumière et le bruit du monde, jusqu’aux mots sur le papier qui bruissaient trop fort. »
Le précédent roman de Laurence Vilaine s’intitulait Le silence ne sera qu’un souvenir : dans La Géante, elle explore encore ces espaces du dit et du non-dit, de l’indicible qui s’impose pourtant, et finalement libère et délivre.
« La femme qui monte »
C’est Carmen, « la femme qui monte », au village d’abord, sur la pente de la montagne ensuite.
Car rien n’arrête Carmen, et suivie par Noële, elle s’élance vers le sommet de La Géante: pourquoi ? C’est le nœud de l’histoire… « Reculer est impossible, j’ai obéi à la montagne. » « Une caboche comme ça, ça ne plie pas, ça fait un double nœud à ses lacets et ça tient tête au ciel, ça part sur les routes qu’il tempête ou qu’il grêle. » dit la narratrice.
Un mouvement impossible donc à inverser, une nécessité, une urgence : « Sans gravir les montagnes, à moins d’être un oiseau de tout là-haut, on ne peut pas savoir ce qu’il y a derrière ». Pour les deux personnages et pour le lecteur aussi, qui monte avec elles. Car Laurence Vilaine, en écrivant au présent et avec une attention aux moindres sensations, aux bruits, aux odeurs, aux couleurs, fortes ou ténues, fait littéralement vivre l’ascension et (r)éveille des perceptions inconnues ou oubliées.
C’est cela aussi la force de l’écriture de l’auteure : l’évocation des sensations est, en effet, tout au long du roman, une manière de saisir les personnages, leurs sentiments, leurs comportements. Le récit s’enrichit, – je dirais même qu’il se tisse ainsi, tant cette écriture est la marque du style de Laurence – grâce à des détails parfois infimes, mais hautement révélateurs. Images inattendues, qui parlent à l’imagination.
Le roman est une habile construction entre le présent de ce temps de la montée, et les retours en arrière qui dévoilent peu à peu au lecteur une histoire bien plus complexe qu’il n’y paraît. Gravir la montagne, c’est pour lui aussi une aventure.
« Le secret de l’amour »
Le personnage de Noële, la narratrice, dont le « je » n’est évidemment pas celui de l’auteure fait pourtant entendre la voix singulière de Laurence Vilaine, son style simple et travaillé, les images et les expressions qui surprennent en touchant juste. Elle « est » le personnage à qui elle donne la parole. Difficile de dire comment cette symbiose est possible, mais pas de doute les deux voix sont parfaitement complices.
Noële est une femme simple, qui ne sait pas ce qu’est le désir, l’amour. Elle ne quitte jamais son petit village. Et soudain son univers s’ouvre grâce à l’arrivée de Maxim, puis de Carmen. On la voit découvrir « le secret de l’amour » grâce à la lecture des mots de Carmen. « Je sais », « j’ai appris », « j’ai compris », dit-elle, ce qu’est l’attente, le désir, la peur, elle le sait maintenant non pas de manière abstraite mais dans la réalité sensible d’un amour vécu. C’est une révélation, plus que cela une (re)naissance : « Je marchais morte, morte de marcher à côté de l’essentiel ».
J’aurais aimé parler de Maxim, l’homme solitaire, qui a « du triste et du dur dans ses yeux clairs » et que la maladie rend aveugle, de Rimbaud, « qui jamais ne parle à personne »mais « qui écoute, qui sent et qui touche » et « qui ouvre le chemin dans la nuit pour apprendre aux yeux qui peut-être un jour n’y verraient plus. » La place manque.
Editions Zulma, 2020